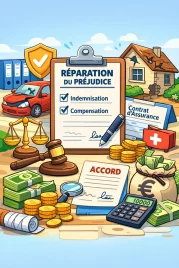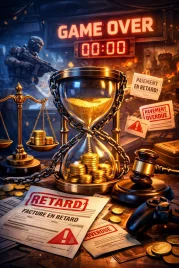Il est rare qu’on se quitte bien, car si on était bien, on ne se quitterait pas, nous disait Proust. Notre arrêt vient illustrer cette idée. Nous sommes en présence d’un titulaire de contrat qui souhaite en faire appliquer les modalités. La personne publique estime quant à elle avoir tacitement résilié ce contrat.
Quelles sont les modalités de résiliation des contrats publics ?
En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante.
En effet, l’administration contractante « peut, en tout état de cause et en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, mettre fin avant terme aux marchés publics, sous réserve des droits à indemnités des intéressés » (CE Ass. 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval).
Cependant, le juge administratif rappelle qu’en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat est regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.
Cet arrêt est en ce sens dans la lignée de celui du Conseil d’État, du 27 février 2019, n°414114.[1]
L’existence d’une résiliation tacite du contrat s’apprécie alors au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Une résiliation tacite actée ?
A la suite d’une réunion, l’ensemble des réunions programmées avec la société requérante pour la finalisation des prestations ont été annulées pour des motifs d’indisponibilité par l’acheteur. A la suite d’une nouvelle réunion annulée, l’acheteur n’a pas repris contact avec la société malgré l’envoi des factures et une demande de rendez-vous en vue de finaliser le projet.
Par ailleurs, en parallèle, l’acheteur a signé plusieurs bons de commande le 21 novembre 2018 ayant le même objet que les marchés litigieux.
L’acheteur public doit donc être regardé comme ayant tacitement résilié les marchés qui le liaient à la société requérante au plus tard le 21 novembre 2018.
Cependant le motif d’intérêt général avancé par l’acheteur, tiré de l’abandon du projet, est contredit par les bons de commande signés en vue de l’acquisition d’une solution similaire. La société requérante a donc droit, outre le règlement des prestations effectuées, à la réparation intégrale du préjudice subi et de son manque à gagner.
CAA Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE01377
[1] Voir également Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 427616